Les malades en phase terminale : une perspective éthique orthodoxe
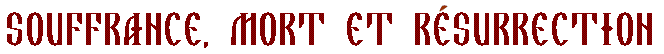

La Descente de la Croix |

par Père Jean Breck |
UNE PERSPECTIVE ÉTHIQUE ORTHODOXE
I LA MÉDICINE MODERNE FACE À LA MORT
L’objet de cette étude est d’examiner les questions qui se posent au sujet des malades en phase terminale ainsi que des nouveau-nés handicapés ou malformés. Un débat est ouvert : faut-il ou non soigner, ou continuer de soigner, ces malades ? Quelles sont les différentes méthodes de " non-traitement ", et à quels critères chacune d’elles répond-elle ?
Il y a une dizaine d’années encore peu de personnes, en dehors de la profession médicale, s’intéressaient à ce problème. Aujourd’hui, à la suite des progrès réalisés dans le domaine des techniques de maintien en vie et de la prise de conscience morale accrue au sein de la société vis-à-vis des patients au stade terminal de la maladie, le problème occupe une place de premier plan dans les facultés, les assemblées législatives ainsi que dans les milieux hospitaliers et les organismes qui s’intéressent aux questions éthiques et morales. Il s’agit d’une question qui exige une réponse prompte et responsable de la part des autorités traditionnelles chrétiennes. L’Orthodoxie identifie le " magisterium " [de l’Église] au " consensus fidelium ", la voix des fidèles inspirée par l’Esprit. Il est donc normal que les membres de la Orthodox Christian Association of Medicine, Psychology and Religion (OCAMPR) (Association orthodoxe chrétienne de médecine, psychologie et religion) se penchent sur le problème afin de juger si ce que on appelle aux États-Unis le " non-traitement sélectif " est un processus valable et de proposer des critères permettant de prendre les décisions appropriées au sujet des soins médicaux et infirmiers à donner aux personnes en fin de vie. [" Non-traitement sélectif " : Il s’agit de tout ce qu’englobe en français le terme populaire d’" acharnement thérapeutique ".]
Selon le Serment d’Hippocrate, le médecin s’engage solennellement à prescrire aux malades, dans toute la mesure de ses forces et de ses connaissances les soins " capables de les soulager et d’écarter d’eux tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible ". C’est de ce serment que découlent les principes de bienfaisance : l’engagement de tout mettre en oeuvre pour promouvoir les intérêts vitaux des malades ; et de non malfaisance : l’engagement d’écarter du malade tout mal qui pourrait advenir soit par négligence, soit par intention volontaire. Ces deux principes, avec le Serment lui-même et le sixième commandement du Décalogue, fournissent une garantie philosophique contre toute tentative d’euthanasie active (mercy killing : donner la mort par " miséricorde "), même dans les cas où le malade est dans un état de coma irréversible ou souffre de douleurs incoercibles. Ils reflètent le point de vue qui constitue la norme pour la tradition judéo-chrétienne, selon lequel le principe du " caractère sacré " de la vie passe avant toute autre considération et ne peut pas être écarté en faveur d’une soi-disant " qualité de vie ".
Jusqu’à ces dernières années, la perspectives religieuse qui établissait ces critères ne semblait poser aucun problème et ne donnait lieu à aucune question. Si Dieu est l’auteur de la vie, il est également le Seigneur, le maître de la mort et du processus de mort. Cependant, avec les progrès de maintien artificiel en état de vie (dialyse, transfusion, perfusion, chimiothérapie. assistance respiratoire etc., y compris la possibilité de transplantation d’organes vitaux comme le foie et le cœur), de nouveaux problèmes moraux sont soulevés qui jusqu’ici étaient ou bien inimaginables ou bien dont la solution était considérée comme acquise, inébranlable une fois pour toutes.
Il est maintenant possible de maintenir artificiellement l’existence biologique pendant de longues périodes de temps, même lorsque il n’y a pas d’espoir de guérison. De ce fait, le dossier des rapports entre le " caractère sacré " de la vie et la " qualité " de la vie doit être réouvert. Les problèmes qui en découlent, comme ceux concernant la gestion d’un budget limité et celui du fardeau financier potentiel pesant sur le malade, sa famille et la communauté, doivent être étudiés. Trois voies morales se proposent. Selon la première, que l’on appelle " vitaliste ", la vie biologique doit être maintenue à quelque prix que ce soit, par tous les moyens possibles. Bien que cette façon de voir semble constituer a priori une noble défense du principe du " caractère sacré " de la vie, il s’agit en fait d’une forme d’idolâtrie biologique, qui accorde à la valeur abstraite de l’existence physique maintenue la priorité par rapport aux besoins personnels et à la destinée ultime du malade.
La deuxième approche, en faveur de diverses formes d’euthanasie, soutient que les malades au stade terminal ont le droit de choisir le moment et la façon dont ils vont mourir ; il s’agit, nous dit-on, de défendre le droit à la " mort dans la dignité " (ou " mort douce "). Comme on l’a vu lors d’un récent débat, cependant, le slogan " mort dans la dignité " peut servir à couvrir un grand nombre d’attitudes et de pratiques qui ne se préoccupent guère du bien-être spirituel ou physique ultime du malade. Et dans la mesure où cette attitude prône en pratique l’euthanasie active sous une forme ou sous une autre, elle favorise involontairement en fin de compte " la mort dans l’indignité " en encourageant l’homicide ou le suicide.
La troisième voie, plus proche de la perspective chrétienne, maintient qu’à un moment donné du processus de mort, le " non-traitement " (c’est-à-dire la cessation de tout moyen de prolongation artificielle de la vie) peut être moralement justifié, permettant au malade d’avoir une mort " naturelle ". Cependant, même cette dernière façon de voir les choses soulève un certain nombre de questions épineuses. Choisir la méthode de " non-traitement ", que l’on appelle communément " débrancher " le malade, revient-il vraiment à laisser la nature suivre son cours ? Ou bien cela correspond-il à pratiquer une forme illicite d’euthanasie ? En d’autres termes, le non-traitement est-il jamais moralement justifié, étant donné que son but est de hâter la mort du malade, même si cette mort se produit par des moyens naturels ? Et que dire des différences qui existent entre diverses formes de non-traitement : doit-on faire par exemple une distinction morale entre supprimer un respirateur et retirer une sonde d’alimentation ? Finalement, peut-on éthiquement considérer comme véritablement " passive " la forme de non-traitement qui constitue en fait un acte de " négligence dans un but bienfaisant " ? Ou bien le fait de pratiquer le non-traitement, si on le considère sous l’aspect de l’intention, ne correspond-il pas toujours une intervention active, une forme d’euthanasie que l’on peut qualifier d’homicide sinon de meurtre ?
Des questions de ce genre se posent généralement à propos de malades aux derniers stades de maladies à issue potentiellement fatale, comme le cancer. Elles s’appliquent également aux enfants nouveau-nés qui, en raison d’anomalies génétiques ou autres, syndrome de drogues ou d’alcool dès l’état pré-natal, traumatisme de l’accouchement, ou autres anomalies et malformations, sont placés dans la catégorie des nouveau-nés malformés, sans espoir de guérison. Dans tous ces cas terminaux, la question fondamentale à laquelle une réponse doit être fournie est la suivante : quelles sont les limites jusqu’auxquelles la technologie médicale doit être mise en œuvre pour maintenir l’existence biologique ? Avant de pouvoir déterminer le critère établissant de telles limites, il nous faut tout d’abord tenter de comprendre ce que signifient pour l’Orthodoxie la nature humaine et le but de la vie de l’homme.
II LA SOUFFRANCE ET LA MORT DANS L’ÉCONOMIE DIVINE
Selon l’anthropologie orthodoxe, l’homme (en tant que terme générique pour les hommes et les femmes), est créé à l’" image " de Dieu et est appelé à croître vers la " ressemblance " de Dieu, à assumer les qualités ou les vertus de la vie divine elle-même. Ce processus de croissance vers la " ressemblance " de Dieu, appelé " théosis " ou " déification ", résulte de l’initiative divine. La grâce sanctifiante qui effectue la transfiguration de l’existence humaine consiste en énergie divine ou attributs de la Divinité, insufflés dans la vie personnelle du croyant par l’action de l’Esprit Saint. L’initiative divine, cependant, doit être complétée par l’initiative humaine. En conséquence, la theosis est le résultat de la volonté humaine œuvrant avec la volonté divine en un processus connu sous le nom de " synergie ", ou coopération entre l’homme et Dieu. Son but est de faire revenir la personne humaine à l’état primordial de perfection mythiquement décrit dans le récit de la création (Genèse, ch. 2-3). Cet état primordial est celui d’avant la chute et n’est donc pas affecté par le péché, ni soumis à la mort qui en est la conséquence.
Cela veut dire que la mort est une anomalie au sein de l’ordre créé. C’est une intrusion involontaire, non voulue, dans les affaires humaines, qui doit être vaincue si la vie humaine doit atteindre son but véritable, qui est celui de la pleine réalisation. Alors que la mort de l’organisme physique peut être considérée soit comme une bénédiction, mettant fin à l’aliénation de l’homme d’avec Dieu, soit comme une partie naturelle et nécessaire du cycle de la vie, elle reste du point de vue de la théologie et de l’expérience orthodoxes un ennemi spirituel qui est autant la cause du péché de l’homme qu’elle en est la conséquence. Dans la mesure où la peur de la mort provoque la rébellion, l’agressivité et l’aliénation de Dieu et des autres, la mort elle-même ne peut pas raisonnablement être jugée moralement neutre.
La théologie orthodoxe comprend la vie comme un don de Dieu, qui doit être reçu avec reconnaissance et un sens de la responsabilité. Dieu nous a choisis non pour la mort, mais pour la vie, dont le telos, ou but ultime, est la communion éternelle avec les Personnes de la Sainte Trinité. Cela, à son tour, signifie que nous devrions concevoir et gérer notre vie dans la perspective que nous aurons à en rendre compte. Bien que don librement conféré comme les talents de la parabole évangélique, l’existence humaine implique notre responsabilité envers Dieu, pour servir sa gloire et le salut du monde qui est sien. Finalement, c’est dans la célébration que la vie humaine trouve sa signification. Créés à l’image divine et appelés à assumer la ressemblance divine, nous devons faire de notre existence une anaphore perpétuelle, une " offrande " de nous-mêmes et du cosmos dans son ensemble. Dans ce mouvement du cœur vers la vie divine, cette transfiguration du corps de chair en un corps spirituel, la mort reste le dernier ennemi. En réalité, son pouvoir destructeur a été vaincu par la puissance plus forte de la Croix, mais elle reste comme l’obstacle ultime entre nous-même et la plénitude de la nouvelle vie en Christ inaugurée par notre baptême et qui sera amenée à sa plénitude dans le Royaume de Dieu.
Du point de vue chrétien, notre véritable mort et notre renaissance ont lieu lorsque nous sommes plongés dans les eaux baptismales et qu’au nom de la Sainte Trinité nous émergeons et sommes unis à la communion des saints, vivants et morts, qui constituent le corps de notre Seigneur glorifié. On peut donc dire que par la Croix du Christ la mort physique ne nous menace plus ; elle a perdu son aiguillon. Le dernier ennemi a été transformé en un passage bienvenu qui conduit vers la vie et la joie éternelles.
Ceci étant, le " dernier ennemi " continue cependant à nous dominer sous la forme du processus de la mort. La crainte de souffrances prolongées et sans signification, plus que la mort elle-même, est la cause principale de l’angoisse et du désespoir de ceux qui sont en fin de vie. Pour déterminer les limites du régime de " non-traitement " choisi, il faut comprendre la signification de la souffrance dans l’expérience chrétienne et savoir dans quelle mesure la souffrance possède des qualités rédemptrices.
Les exploits ascétiques des Pères du désert et d’autres ascètes chrétiens témoignent de façon éloquente de la réalité des " souffrances rédemptrices ". Certaines formes de souffrances mentales et physiques, distinctes mais souvent associées à la douleur, peuvent nous faire croître spirituellement de trois manières. En premier lieu, la souffrance rend indéniable la réalité de notre propre péché, de nos faiblesses et de nos manquements. Contrairement à Job, notre patience est limitée et la souffrance nous offre la tentation constante de " maudire Dieu et de mourir " (cf. Jb 2,9). Deuxièmement, une fois que nous nous rendons compte au milieu de nos souffrances que nous sommes incapables de nous sauver nous-même, nous pouvons – comme Job – obéir à l’impulsion divine qui nous pousse à nous confier à la miséricorde de Dieu comme étant notre seule source d’espoir et de force ; en nous obligeant à choisir sans cesse entre Dieu et le désespoir, la souffrance peut atteindre la qualité d’une discipline ascétique, qui triomphe des passions de la chair et de l’esprit.
Toute souffrance cependant n’est pas rédemptrice. Au delà d’un certain seuil elle déshumanise, brisant la volonté et réduisant à néant les meilleures intentions du cœur. De telles souffrances peuvent être produites par des facteurs extérieurs au delà de notre contrôle : la torture, la douleur physique excessive due à la maladie, ou une angoisse mentale provenant de menaces extérieures. Des chercheurs se rendent actuellement compte que d’autres formes de souffrances peuvent également être dégradantes et dépourvues de qualités " rédemptrices ". Tous les hommes ne sont pas des saints Ignace d’Antioche, prêts à faire face psychologiquement et spirituellement à la mort du martyr dans l’arène. Les victimes d’abus sexuels dans l’enfance, par exemple, ou des personnes ayant souffert de pertes irrémédiables ou d’abandon, peuvent être si profondément blessées que la peur même de la souffrance – vue comme une punition supplémentaire – peut provoquer en elles un désespoir et une crainte incontrôlables.
Finalement, il faut admettre que la souffrance comprend souvent un élément de l’absurde. Nous ne pouvons pas tout bonnement tenir pour acquis que toute tragédie dans l’existence humaine vient de la volonté de Dieu. Dans l’Évangile de Jean da guérison de l’aveugle-né, Jn 9,1-40), Jésus affirme sans équivoque que la souffrance et la culpabilité ne sont pas nécessairement reliées. Dieu permet la tragédie, oui. Dans la prière des Pères d’Optino, nous supplions Dieu : " Apprends-moi à accepter d’une âme sereine tous les imprévisibles de la journée.., donne-moi la conviction profonde que rien n’arrive que ce ne soit avec ton agrément... que je me souvienne que tout événement imprévu l’est avec ton accord ". Cependant il est impensable que le Dieu de miséricorde et de compassion soit d’accord pour permettre – dans le sens de vouloir et de désirer – la torture, les bombes des terroristes ou des tremblements de terre effroyables comme nous en avons connu ces dernières années. Si nous affirmons que " rien n’arrive que ce ne soit selon la volonté de Dieu ", nous devons tout de même insister sur la distinction fondamentale entre ce qui est la volonté de Dieu et son désir et ses intentions. Dieu ne désire pas que ses créatures, si rebelles soient-elles, soient les victimes de souffrances déshumanisantes. Cependant, dans le mystère insondable de l’économie divine, il se peut que ce soit selon sa volonté que nous passions par de telles expériences.
Tout ce que nous pouvons savoir à cet égard, toutefois, est en fait tout ce que nous avons besoin de connaître au sujet du mystère de la souffrance humane. Et c’est que, en dépit de l’élément de l’absurde qui lui est inhérent, Dieu nous accompagne dans notre souffrance : il la connaît et la partage pleinement. En tant que Serviteur souffrant, Il a le pouvoir de transformer n angoisse sans signification en une expérience véritablement rédemptrice. Là où la personne est devenue incapable de ressentir cette qualité rédemptrice à cause de l’intensité de la douleur physique ou mentale, il reste la possibilité d’une souffrance rédemptrice portée par un Autre, par celui qui demeure à jamais " le Crucifié " (Mc 16,6), ainsi que par la présence, l’intercession et l’amour de ceux qui portent et partagent le fardeau de celui qui est affligé.
Ainsi vue à la lumière de la passion et de la mort sacrificielle du Christ lui-même, toute souffrance est potentiellement rédemptrice. La prière ecclésiale et la solidarité des membres du Corps du Christ peuvent faire de la tragédie la plus apparemment " dépourvue de sens ", un témoignage de la Croix et de la vérité que la Vie a vaincu la mort.
III LE BIEN-ÊTRE SPIRITUEL DU MALADE
Appliquant ces réflexions concernant la vie et la souffrance humaines à la situation de ceux qui sont au stade final de leur maladie, nous pouvons proposer quelques lignes directrices qui pourraient être utiles à ceux qui soignent professionnellement le mourant et à tous ceux qui l’accompagnent.
Tout d’abord, il convient de surmonter l’opposition existant entre d’une part le " vitalisme " et de l’autre l’euthanasie destinée à assurer la " mort dans la dignité ". Il s’agit dans le premier cas d’une idolâtrie manifeste qui refuse d’admettre que la signification et la fin ultime de la vie humaine se situent au delà de l’horizon de la mort biologique. Pour ce qui est du deuxième cas, nous sommes en fait en présence d’une ingénieuse alliance de notions contradictoires en soi, dans la mesure où il n’y a pas de " bonne " mort. La mort est, et restera toujours, tragique dans son essence même. L’espérance chrétienne est enracinée non dans l’attente de la mort mais dans celle de sa défaite, son annihilation par l’instrument de la mort lui-même : " Par la mort il a vaincu la mort ! " Ainsi donc l’euthanasie, qu’elle soit active ou passive, volontaire ou involontaire, n’apporte pas de solution au problème que pose le fait de devoir mourir, si ce n’est d’avancer l’heure de l’inéluctable.
Le critère ultime qui doit être utilisé pour déterminer si le non-traitement est approprié à telle ou telle situation donnée est celui du bien-être spirituel du malade. Cela veut dire que les principes du " caractère sacré " de la vie et de sa " qualité " ne doivent plus s’exclure mutuellement. Le " caractère sacré " de l’existence humaine n’est pas nécessairement préservé par le main tien des fonctions biologiques. La " qualité " de la vie n’est pas elle non plus assurée par le fait de "débrancher" le malade ou de lui administrer une piqûre mortelle. Qu’est-ce qui constitue la " qualité " de vie d’un malade en état de coma irréversible ? Les paroles de la Bien-aimée du Cantique des Cantiques de Salomon : " Je dors, mais mon cœur veille " (Ct 5,2) ne peuvent-elles pas L s’appliquer ici ? Les abîmes de l’inconscience ne sont-ils pas peut-être comparable à ceux du schéol dans la vision du psalmiste : " Si je monte au ciel, tu y es, si je descends aux enfers, tu es là " (Ps 138,8) ?
Quoi qu’il en soit, étant donné la dimension de transcendance de l’existence humaine, le respect du caractère sacré de la vie doit toujours prendre en considération sa qualité spirituelle. Cela signifie entre autres qu’il nous faut méditer avec le plus grand sérieux les prières traditionnelles de l’Église pour que la séparation de l’âme et du corps s’accomplisse dans la paix. Lorsqu’un malade est en état de coma irréversible (dans la mesure où cela peut humainement être constaté), ou en proie à des souffrances intolérables que les médicaments ne peuvent pas soulager, alors le personnel médical moralement responsable ne retiendra pas comme objectif essentiel la nécessité de perpétuer cet état.
Le traitement médical se doit d’accorder toujours la priorité aux besoins du malade. Alors que les soins appropriés et l’alimentation sont nécessaires pour éviter le risques d’infection et limiter la détérioration de l’état physique, la considération primordiale dans le cas des mourants doit être de soulager les souffrances et les douleurs physiques et psychologiques. Une " bonne " mort ne peut advenir que grâce à un " bon " mourir. Le but primordial de l’équipe médicale ne doit donc pas être de prolonger la vie du mourant, mais bien plutôt de soulager la souffrance, de sorte que le malade puisse être en mesure de puiser au maximum dans ses propres ressources spirituelles. La " séparation de l’âme et du corps dans la paix " demande que le malade soit suffisamment libéré des douleurs et autres formes de souffrance pour pouvoir se préparer à la mort de façon adéquate. Le fait de lui administrer des médicaments appropriés à cet effet ne constitue pas une violation du principe du " caractère sacré " de la vie, même si cela doit avoir pour conséquence secondaire de hâter le moment de la mort.
Personne, hormis le malade lui-même, n’est en mesure de juger si ses souffrances ont une qualité rédemptrice. S’il est dans le coma ou s’il est la proie de grandes souffrances qui ne peuvent être soulagées, il est alors tout-à-fait justifié de mettre fin aux moyens qui prolongent artificiellement la vie et de prescrire des médicaments antalgiques administrés par voie orale ou par injection.
Aujourd’hui toutefois, les tribunaux se trouvent confrontés à un corollaire de ce principe qui soulève des problèmes éthiques très graves : peut-on ou non laisser un malade mourir de faim et de soif ? Y a-t-il une différence morale entre supprimer une aide respiratoire et débrancher une sonde d’alimentation ? Nombreux sont ceux qui pensent qu’il n’y a pas de différence, et les tribunaux semblent de plus en plus se faire l’écho de cette conviction. De même aussi se pose la question de savoir si le processus est volontaire ou non. Une personne au stade terminal de la maladie peut refuser de boire et de s’alimenter, ou des personne responsables peuvent décider de cesser d’alimenter un malade dans le coma ou dans l’impossibilité de prendre des décisions. Le problème dans ce dernier cas est que nous ne savons nullement ce que le malade peut ressentir. Certaines personnes dans le coma peuvent entendre et comprendre tout ce qui est dit par l’entourage, mais ne sont pas capables de communiquer activement. Dans la mesure où un malade dans le coma peut être conscient, la suppression de la sonde d’alimentation est susceptible de causer en lui les affres de celui qui meurt littéralement de faim et de soif. Jusqu’à ce que la science médicale soit capable de déterminer avec exactitude ce que le malade en question lui-même ressent à ce stade du point de vue de la douleur et de la réception des stimulations extérieures, ce serait une faute morale que de lui supprimer l’eau et la nourriture. Nous avons pu dans la revue Time au moment où ces discussions ont commencé : " Si quelqu’un doit mourir de faim deux ou trois semaines après avoir été débranché, pourquoi ne pas lui faire dès maintenant une injection mortelle sans douleur ? " Tout processus qui fait de l’euthanasie active la solution préférée est en soi immoral et doit être rejeté.
Il faut donc reconnaître que refuser d’alimenter et de désaltérer quelqu’un n’est pas la même chose que mettre fin à un quelconque système d’acharnement thérapeutique. La première méthode amène inéluctablement la mort, alors que la seconde, comme cela a été tragiquement démontré dans le cas de Karen Ann Quinlan (1), permet aux ressources de l’organisme de prendre le relais. Que ces ressources soient ou non adéquates pour maintenir la vie, cela est un autre problème. Le critère permanent qui doit servir de guide dans le non-traitement est en dernier ressort le bien-être du mourant. Il se peut que ce bien-être soit assuré au mieux par l’arrêt des méthodes artificielles de maintien en état de survie. Il est certain qu’il ne l’est pas dès lors que la mort est délibérément provoquée.
[(1) La tragédie de Karen Ann Quinlan est la premier cas moderne bien connu du début sur le " droit de mourir." Jeune adulte de 21 ans, Karen Ann Quinlan s'est effondrée après l'ingestion de l'alcool et des tranquillisants à un parti en 1975. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais elle a subi des atteintes au cerveau et est tombée dans un état " végétatif " permanent. Sa famille a engagé une procédure juridique très publicisée pour avoir le droit de " débrancher " ses appareils de soutien de vie. Ils ont réussi, mais Karen Ann a continué de respirer après que le respirateur ait été débranché. Elle est restée dans un coma pendant presque dix ans dans une maison de repos, jusqu'à sa mort en 1985.]
J’ai parlé avec certains médecins orthodoxes qui ne sont pas d’accord là-dessus et qui estiment que cesser d’alimenter et de donner à boire au malade dans les cas manifestements terminaux est un processus médical moralement acceptable. Ils avancent que dans ce cas le malade ne souffre pas et meurt en réalité d’une cause naturelle, puisqu’il n’est pas en meure de s’alimenter lui-même ou de l’être autrement que par des méthodes " extraordinaires ". Lorsque le malade est mourant, et qu’il est clairement établi qu’il ne souffrira pas du fait du manque de nourriture, une telle procédure peut en fait être appropriée. Mais, même si le principe est accepté, chaque cas doit être jugé en lui-même, afin d’assurer dans la mesure du possible le bien-être physique et spirituel de chaque patient.
IV LE RÔLE DE L’ÉGLISE
Quel sont donc finalement le rôle et la responsabilité de l’Église dans l’aide à apporter aux mourants au moment de la mort ? Nous pouvons réfléchir aux objectifs suivants, mais la liste pourrait en être beaucoup plus vaste :
1. Il nous faut tout d’abord reconnaître que le processus de mourir est un phénomène naturel dans le monde déchu et exige le respect et l’attention convenable de tous ceux qui approchent directement le malade. Les prières d’intercession, le sacrement de l’onction des malades, les visites fréquentes au mourant, devraient faire partie de la vie de la communauté chrétienne. L’une des plus grandes raisons de l’angoisse et de la souffrance morale des malades en stade terminal est la solitude et l’isolement. Pour agir dans de telles situations, la famille, les amis, le personnel hospitalier, doivent surmonter leur tendance naturelle à s’éloigner devant l’approche de la mort. Ils doivent au contraire aller vers le malade avec compréhension, compassion et amour.
2. La communauté ecclésiale peut créer un réseau de personnes aidantes composé de soignants, de prêtres et d’autres, pouvant apporter aide et conseils, par exemple lors de la prise de décisions cruciales relatives à la poursuite ou à la non-poursuite du traitement du mourant. Cela pourrait être particulièrement utile dans les cas où le médecin traitant voudrait mettre en œuvre des processus auxquels le malade ou ses représentants sont hostiles.
3. Les Églises, au niveau national et local, devraient encourager le développement de structures caritatives et de dispositifs " d’accompagnement et de soutien aux personnes en fin de vie et à leur famille ", destinés à offrir des soins palliatifs et à accompagner la vie jusqu’à son terme au niveau social, médical et relationnel, dans le but de conserver et d’accroître la dimension spirituelle de la vie humaine et du mourir. De tels programmes se sont déjà avérés utiles, en soulageant de l’angoisse qui entoure la mort les malades en phase terminal et en leur fournissant, là où ils peuvent fonctionner paisiblement et de façon créative, un environnement de soutien et un accompagnement. Que ce soit par le moyen d’institutions spécialisées ou de soins médicaux et infirmiers à domicile et la concertation médico-sociale, les programmes de soutien et d’accompagnement constituent de loin la meilleure alternative possible de l’hospitalisation. Et en réduisant de façon considérable la souffrance et l’angoisse, ils apportent des arguments importants contre l’euthanasie active.
4. Les Églises devraient en outre apporter leur soutien à certains projets législatifs relatifs à la " mort naturelle " rédigés avec soin et destinés à garantir que les malades en stade terminal ne soient pas utilisés dans un but expérimental ou soumis aux conséquences de la philosophie " vitaliste " d’un médecin quelconque. De même, elles devraient encourager une législation uniformisée relative aux " testaments biologiques " dont le seul rôle devrait être d’empêcher que l’on puisse imposer des traitements non bienfaisants ou extraordinaires. Tout cela devrait servir à protéger aussi bien la stabilité financière de la famille du malade que les droits du malade lui-même quant à l’administration de tels traitements.
5. Les Églises devraient militer avec énergie par les homélies, l’enseignement et tous les autres moyens appropriés, contre l’attitude générale aux États-Unis aujourd’hui, qui fait du serment d’Hippocrate et de la profession médicale dans son ensemble, une pure moquerie. C’est l’attitude de ceux qui prétendent que le traitement médical n’est ni un droit ni un privilège, dû et accordé par la société à ses membres, mais un " service " proposé à ceux qui ont les moyens de payer. Les États-Unis sont actuellement la seule démocratie industrielle importante n’ayant pas un service de sécurité sociale complet pour tous les citoyens. Seules les Églises ont suffisamment de pouvoir de persuasion morale pour convaincre le public et les législateurs que des soins médicaux complets sont encore plus cruciaux pour la vie sociale de la nation qu’une saine politique au plan économique et de la défense. C’est donc aux Églises de faire vigoureusement campagne pour qu’un service social et médical de qualité soit mis à la portée et à la disposition de tout un chacun.
6. Enfin, les prêtres et les pasteurs devraient proclamer dans leurs sermons et au cours de la vie liturgique de leurs communautés que Dieu est le Seigneur aussi bien de la vie que de la mort ; il est la seule source d’espoir ultime pour ceux qui sont au stade final de la maladie. Nous tous, sans exception, sommes " au stade final de la maladie ". Dès lors que nous pouvons assumer cette perspective, nous pourrons peut-être prier avec conviction et un espoir sans faille qu’il accorde à chacun de nous la grâce d’" une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte et dans la paix ".
Exposé fait devant les membres de la Orthodox Christian
Association of Medicine, Psychology and Religion
à Bethesda, Maryland, le 13 janvier 1989.
Traduit par Paula Minet.
Publié dans Contacts, no. 149 (1990).
Souffrance, Mort et Résurrrection - Introduction