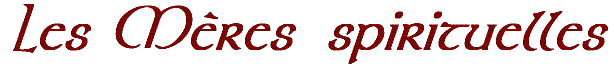Sainte Juliana Lazarevskaia
|
|
|
par Élisabeth Behr-Sigel
|
|
Parmi les personnes vénérées comme saintes par le peuple de la Russie moscovite, on trouve aussi une dizaine de femmes, pour la plupart princesses ou religieuses, parfois les deux ensemble. C’est le cas de la princesse Anne Kachinskaïa dont la forte personnalité transparaît dans le récit hagiographique de sa vie. Sur la plupart de ces saintes femmes, les renseignements précis font défaut. On sait peu de chose sur leur " exploit " spirituel et leur vie intérieure reste ignorée. Les moniales russes n’ont eu ni leur Catherine de Sienne, ni leur Thérèse d’Avila, ni même leur saint Basile pour écrire leur panégyrique, comme ce dernier le fit pour sa sœur Macrine. Cette indigence pourrait s’expliquer par le niveau généralement bas de la culture littéraire qui affectait les femmes encore plus que les hommes ; à quoi s’ajoute, comme le suggère G. Fedotov, " la condition humiliée de la femme " dans la Russie ancienne.
Une figure pourtant émerge de cette obscurité générale : Exceptionnelle, animée d’une charité héroïque, Juliana Lazarevskaïa incarne, portées à leur point culminant, les vertus de milliers de femmes chrétiennes russes que l’histoire a ignorées. Sa place dans l’hagiographie moscovite est unique. Ni princesse, ni fondatrice de monastère, elle est la seule à y figurer en tant que femme mariée, mère de nombreux enfants ; la seule aussi dont la biographie fort précise, nullement noyée dans une brume de légende dorée, ait été écrite par son propre fils. Rédigée en slavon d’église, ce texte dont les deux versions – l’une plus longue, l’autre abrégée – sont parvenues jusqu’à nous, s’écarte notablement du modèle stylisé de la " vie de saint " traditionnelle. Monument de piété filiale, l’œuvre de Droujina Ossorguine amorce l’art et la technique de la biographie moderne.
Née sous le règne du tsar Jean IV le Terrible que servait son père, morte en 1604, au temps de Boris Godounov, Juliana appartenait à une famille de la moyenne noblesse, celle des serviteurs du Tsar que ce dernier récompense en leur donnant des terres. Sa vie, comme celle de beaucoup de femmes russes de cette époque, fut jalonnée d’épreuves. Orpheline de mère à six ans, elle est élevée dans la famille d’une tante, où la piété précoce et les tendances ascétiques le l’adolescente sont l’objet de moqueries, sinon de blâme. Quand elle a 16 ans, on la marie à Georges Ossorguine, un noble assez aisé de la région de Mourom. Elle en a treize enfants dont sept meurent en bas âge. Deux autres fils périssent de mort violente, l’un à la guerre, l’autre au cours d’une rixe où il est tué par un de ses serfs. Occupé au service du Tsar, le mari est presque toujours absent. Juliana dirige la maison et l’exploitation agricole, d’abord sous la tutelle de ses beaux-parents auxquels elle est humblement soumise, puis seule après leur mort. Les temps et les gens sont durs. Juliana doit faire face aux disputes qui opposent entre eux ses enfants et les domestiques, en même temps qu’à la famine et aux épidémies qui ravagent la Russie. Alors que les nobles, ses voisins, stockent leurs récoltes pour bénéficier de la hausse des prix dûes à la pénurie, la jeune femme ouvre ses greniers et nourrit les affamés. Elle ira jusqu’à vendre ses propres vêtements pour acheter la nourriture des pauvres. Bravant le risque de contagion, elle soigne elle-même les malades et ensevelit les morts. Devenue veuve, elle partage entre ses enfants le domaine familial de Lazarevo et s’en va vivre dans un autre village. Survient alors une nouvelle famine. Ayant distribué tout ce qu’elle possède, Juliana tombe dans le plus grand dénuement. Elle prend alors la décision de libérer ses serfs en leur laissant le choix soit de s’en aller pour chercher ailleurs leur subsistance, soit de demeurer auprès d’elle. Ceux qui restent sont nourris par elle d’un pain fait avec une herbe nommée lébéda et d’écorces d’arbre finement moulues. Miraculeusement (ou peut-être aussi grâce à son talent) ce pain est d’un goût excellent.
Tombée malade en décembre 1605, Juliana meurt au mois de janvier suivant. On l’ensevelit dans l’église de Saint-Lazare au village de Lazarevo. Dix ans plus tard, quand meurt son fils Droujina, auteur de sa biographie, Juliana est déjà en odeur de sainteté parmi les gens du pays de Mourom. Cette vénération locale spontanée sera officialisée au XIXe siècle sans qu’il y ait une véritable canonisation. Une icône que l’on dit " miraculeuse " représente Juliana debout devant le Christ qui, d’une main la bénit, alors que l’autre tient le livre des Évangiles1.
L’important est le message qui se dégage de cette vie et que le biographe, très consciemment – semble-t-il – s’est efforcé de transmettre. Au dire de son fils, homme pour son époque d’une culture au-dessus de la moyenne, Juliana n’a reçu aucune formation ni religieuse ni littéraire. Comme beaucoup de femmes de son milieu, elle était presque analphabète. Durant son enfance et son adolescence, on néglige même de la conduire régulièrement à l’église. Mais, souligne son biographe, " son sens intérieur lui apprend tout sans qu’elle ait besoin de lire des livres ". En fait, on trouve chez elle tous les traits qui caractérisent l’évangélisme russe traditionnel : humilité, douceur, compassion, aspiration au dépouillement de soi poussée aux extrêmes limites. Vers la fin de sa vie, ayant tout donné, elle est si pauvre qu’elle ne peut plus ou n’ose plus se rendre à l’église distante de quelques verstes de son domicile. À cela s’ajoute un sens aigu – nouveau et exceptionnel dans son milieu – de la dignité de tout être humain. Son fils note qu’elle s’adresse toujours à ses serviteurs en les nommant de leur nom suivi du patronyme (ce qui est une formule de politesse équivalent au " Monsieur " ou " Madame " de la langue française). Ne les réprimandant jamais durement ou grossièrement, elle voit en eux des êtres capables de prendre librement une décision : par exemple, de la quitter ou de rester avec elle au temps de la famine.
Les historiens soviétiques qui se sont penchés sur la " Vie " de Juliana ont cru y discerner des traits d’anticléricalisme et une attitude critique à l’égard du monachisme. Il est exact qu’à plusieurs époques de sa vie Juliana semble avoir peu fréquenté le culte public : fait qui étonne, voire scandalise le clergé paroissial et que Droujina croit nécessaire d’expliquer en donnant des raisons plausibles et en invoquant une justification surnaturelle. Ainsi la prêtre qui se pose des questions au sujet de l’absence de Juliana, en priant devant l’icône de saint Nicolas, entend une voix qui lui commande de se rendre auprès d’elle et de se prosterner devant elle pour lui demander pardon. Peut-être la critique discrète d’une piété formaliste et ritualiste s’exprime-t-elle, en effet, dans cette anecdote ? Cependant rien n’indique une opposition de principe au monachisme. Sur le point de mourir, Juliana dit son regret de n’avoir pas été jugée digne de suivre la voie " angélique ", c’est-à-dire monastique, comme elle l’eut souhaité.
Il reste que Juliana présente très nettement – et son biographe paraît vouloir le souligner – la plénitude de la vie chrétienne vécue dans le siècle dans les conditions ordinaires d’une femme mariée, mère de nombreux enfants ; dans un milieu où règne la violence tant individuelle que sociale, elle subit le poids des malheurs et catastrophes qui frappent toute la société. En vivant selon l’Évangile dans le monde, ne lui a-t-il fallu autant, sinon plus d’héroïsme que si elle avait pu suivre son désir de se réfugier dans un monastère ? Telle est la question posée implicitement par Droujina Ossorguine en rapportant une scène pathétique de la vie de sa mère. Folle de désespoir après la mort violente de deux de ses fils, s’ajoutant aux sept autres petits morts, Juliana demande à son mari de la laisser prendre l’habit monastique. Devant son refus, elle insiste : " Si tu ne me laisses pas aller, je m’enfuirai de la maison ". Mais le mari la supplie " au nom de Dieu " de ne pas l’abandonner : il se fait vieux et les enfants sont encore jeunes. Pour la convaincre il lui lit des passages des écrits des " Saints Pères " : " L’habit noir2, dit-il, ne nous sauve pas si nous ne vivons pas selon la règle monastique. Et l’habit blanc ne nous perd pas si nous faisons ce qui plaît à Dieu ". Juliana alors répond simplement : " Que la volonté de Dieu soit faite ", et décide de rester auprès des siens.
En Juliana Lazarevskaïa, telle que le présente l’hagiographe, s’ébauche ainsi une nouvelle synthèse : celle de l’idéal ascétique et mystique du monachisme oriental représenté en Russie par Serge de Radonège et Nil Sorski avec l’appel à une présence active, compatissante et diaconale au monde. Il n’est pas indifférent que cette synthèse soit représentée par une femme.
D’investigations récentes sur Juliana Lazareskaïa, il résulte qu’elle connaissait et pratiquait l’oraison hésychaste, la " prière de Jésus ". Telle était l’eucharistie spirituelle dont se nourrissait celle qui distribuait son pain quotidien aux pauvres3.
Extrait de : Élisabeth Behr-Sigel,
Prière et sainteté dans l’Église russe,
2e édition, Bellefontaine, (SO 33), 1982.NOTES
1. Ces détails sont tirés de EUGENE, Évêque de Mouron, Au sujet de la glorification et de la vénération ecclésiastique de sainte Juliana, Saint-Petersbourg, 1910 : livre cité par T.A. GREENAN dans une étude encore inédite.
2. L’habit noir du moine s’oppose dans l’Église Orthodoxe au vêtement blanc ou de couleur du clergé séculier ou des laïcs.
3. Nous tenons à remercier M. GREENAN, senior lecturer de langue et littérature russe à l’université de Liverpool, auteur d’une thèse de doctorat en voie d’achèvement sur Juliana Lazarevskaïa, pour les indications précieuses qu’il a bien voulu nous communiquer.
Introduction aux Pages des Mères spirituelles